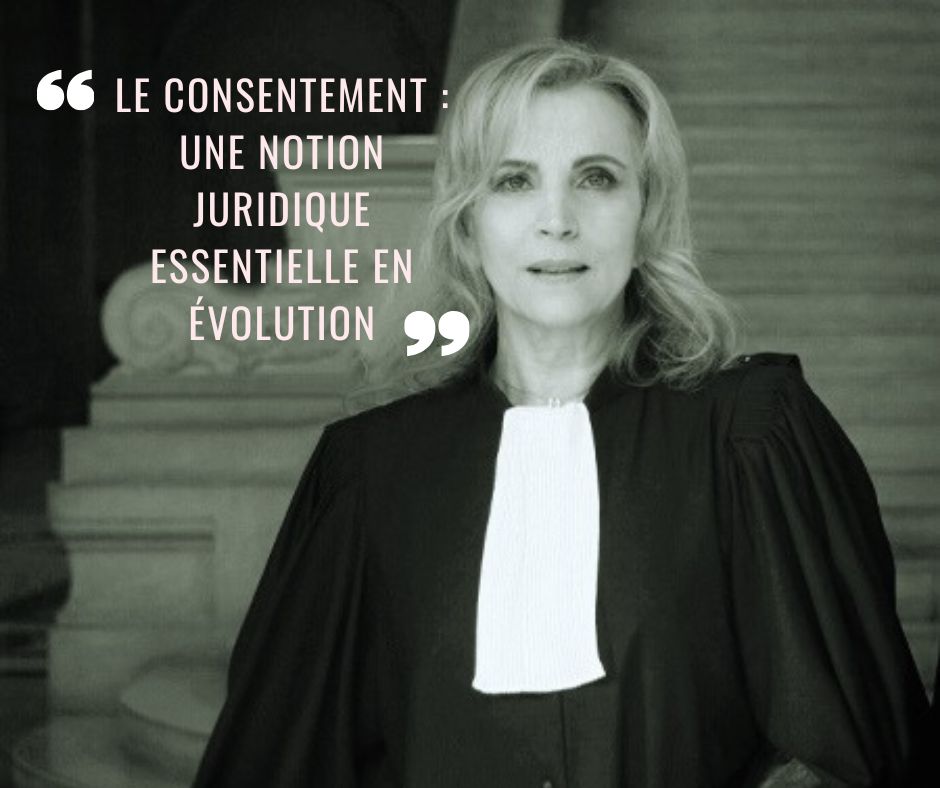
Le consentement : une notion juridique essentielle en évolution
Le consentement, et plus précisément l’absence de consentement, est une notion essentielle dans la caractérisation des violences sexuelles.
« On ne peut plus, en 2024, considérer que parce qu’elle n’a rien dit, c’est qu’elle était d’accord »,
Laure Chabaud, Avocate Générale, Procès Mazan
La notion de consentement permet de mettre en balance les valeurs de l’intégrité physique et la liberté sexuelle, mais avant tout de différencier une relation licite à une relation illicite.
L’enjeu de cette notion est primordiale et va au-delà de la sphère juridique.
L’objectif est de protéger la victime en insistant sur l’importance du consentement.
En France, les infractions sexuelles sont constituées par une atteinte sexuelle commise avec une absence de consentement de la victime.
Cependant, ce défaut de consentement n’est pas inscrit expressément au sein du Code pénal.
L’absence de consentement est caractérisée par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Ainsi, le consentement est ni nommé et ni défini par le Code pénal, ce qui peut poser des difficultés dans l’appréciation des infractions.
Aujourd’hui, une femme qui ne souhaite pas avoir de relation et dit tout simplement non, sans preuve de violence, menace ou contrainte, ne voit pas sa situation reconnue comme étant un viol.
Il s’agit d’une difficulté majeure qui a été exposée lors du procès Mazan dans lequel les avocats des accusés ont tenté de justifier un consentement implicite en mettant en avant l’absence de résistance de la victime.
C’est pourquoi, suite à ce procès, la question de la définition du consentement et de son inscription dans le Code pénal a émergée et a suscité des débats.
Selon les dispositions du Code pénal, le corps d’une personne est « disponible » sauf expression de son non-consentement.
Mais cela devrait être l’inverse, à savoir le corps n’est pas disponible sauf consentement de la personne. Il ne devrait pas y avoir la possibilité de dire « je ne pouvais pas savoir qu’elle ne voulait pas » ou « je ne savais pas qu’elle n’était pas d’accord ».
Aujourd’hui, la société souhaite qu’il y ait une présomption de non consentement qui oblige la personne mise en cause de prouver qu’il y a eu consentement et non à la victime de démontrer un défaut de son consentement par violence, contrainte, menace ou surprise.
Cette conception est présente dans plusieurs pays notamment au Canada où la Cour Suprême a rejeté l’idée que l’absence de résistance physique pouvait être interprété comme un consentement.
En Suède, la notion de consentement affirmatif a été intégré de manière législative en 2018.
Ainsi, c’est à la personne qui souhaite un rapport de s’assurer que l’autre personne a affirmé son consentement et a dit oui. Cette présomption a conduit à un recul d’impunité avec une augmentation de 75% des condamnations et des enquêtes qui sont dorénavant plus concentrées sur l’absence de consentement que sur les preuves de violences physiques.
Enfin, l’Espagne a adopté en 2022 la loi « Solo sí es sí » qui met en avant le critère du consentement explicite en considérant qu’il n’y a consentement que s’il a été librement exprimé. La distinction entre « abus sexuels » et « viol » a également été supprimée par cette même loi.
Toutefois, en plaçant le consentement au centre du débat, la loi a eu pour effet de réduire les peines des délinquants sexuels car désormais les peines sont plus larges mais les peines minimales sont moins élevées. Cela a alors permis la révision de plusieurs condamnations antérieurs et ce en faveur des auteurs.
L’importance du consentement dans l’appréciation des violences sexuelles est donc un enjeu essentiel qui touche à la fois la dimension juridique, culturelle mais également psychologique de la société. La présomption de non consentement peut être une remise en cause des stéréotypes de genre et des violences sexuelles
